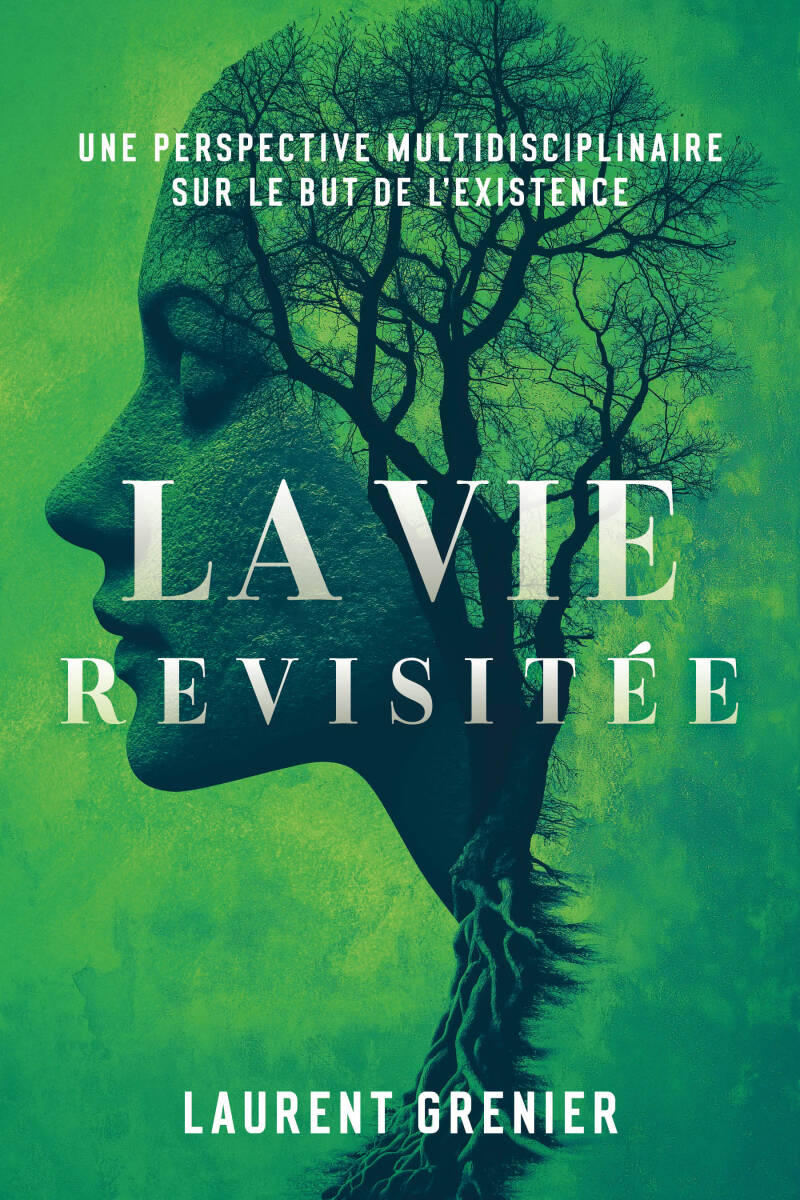
Voici plusieurs extraits de « La vie revisitée » qui donnent un bon aperçu du livre dans son ensemble. Il serait toutefois malavisé de tirer des conclusions hâtives à partir de cet aperçu, puisque le livre en question inclut une argumentation abondante et serrée, étayée par des faits, qui augmente substantiellement sa crédibilité.
* * *
Je vous prie de considérer mon propos non pas comme un point d’arrivée, manière de dernier mot qui prétend faire autorité, mais comme un point de départ vers une réflexion personnelle et originale. À chacun son voyage et sa destination dans le vaste paysage des idées possibles.
…
Notez que j’ai emprunté la voie philosophique alors que j’étais aux prises avec une crise existentielle qui bouleversait complètement le sens que je donnais à ma vie. Un accident de plongeon – accompagné d’une grave lésion médullaire – avait réduit l’athlète adolescent que j’étais en jeune quadriplégique, désormais inapte à réaliser ses rêves. Autrement dit, je suis un autodidacte pour qui la philosophie était au départ un remède contre le sentiment d’absurdité et son corollaire morbide : un désespoir potentiellement suicidaire. Cela contraste avec un universitaire diplômé, surtout motivé par une profonde curiosité intellectuelle.
Notez également que mon parcours informel, en marge des universités, compte près de 40 ans que j’ai consacrés avant tout à la méditation et à l’étude, sans parler de l’écriture. La bibliographie à la fin du présent essai rend hommage aux auteurs qui ont été mes sources principales d’information et d’inspiration. Ces auteurs constituent, en un mot, mon cadre culturel. J’invite quiconque désire situer ma pensée dans ce cadre à consulter ma bibliographie, d’autant plus que je n’use d’aucune citation au cours de mon exposé pour en alléger le style.
…
De même, j’avance l’idée suivante, surtout que rien ne m’incite à penser l’inverse : la réalité (en sa qualité d’être qui s’impose à l’esprit à travers l’expérience) se suffit parfaitement à elle-même et alterne sans cesse, au cours de son déploiement, entre le mode latent et le mode manifeste. Le passé cède sa place au présent, qui cède sa place à l’avenir, mais ce premier comme ce dernier sont toujours des présents dont l’un n’est plus et l’autre pas encore. Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que c’est comme ça, voilà tout. Explication circulaire, certes, qui révèle le mystère d’une évidence ontologique inexplicable, d’un devenir éternel dont l’existence est autant une interrogation qu’une affirmation.
…
Le spectre d’un avenir potentiellement sinistre… est par définition incertain et donc ne légitime aucunement une réaction fataliste et défaitiste, par opposition à constructive et préventive dans la mesure du possible. Nous aurons une éternité pour faire le mort quand tout sera vraiment sens dessus dessous et que la terre prendra la place de l’air dans nos narines. D’ici là, nous sommes tenus de fournir un effort quotidien pour mettre de l’ordre dans nos idées et nos affaires, et ainsi nous montrer dignes de la vie qui nous anime encore.
…
Or, rien dans le cerveau ne mérite autant le qualificatif humain que le néocortex, puisque c’est là que prend forme notre concept d’identité en relation avec le monde – concept fluide à l’image de la vie elle-même, au confluent de la sensibilité, de la mémoire, de la pensée et de l’imaginaire, qui s’articulent autour du langage. Non pas que le reste du cerveau soit moins important (le néocortex ne peut davantage s’en passer qu’un capitaine de vaisseau ne peut se dispenser des services de son équipage pour mener à bien la navigation à travers un océan parfois tumultueux), mais cette partie hautement évoluée de l’ensemble cérébral, qui est la condition de notre éveil à la réalité d’être, offre l’avantage de se prêter à un effort de développement et d’épanouissement personnel.
…
Enfin, on augmente davantage la température de la plaque chauffante, sans pour autant dépasser la mesure et provoquer des turbulences aux irrégularités chaotiques. Cette fois, le liquide bifurque depuis un régime dissipatif plutôt banal vers un autre qui s’en distingue de façon remarquable par l’apparition de cellules de convection dont la forme ordonnée, dynamique et stable s’apparente à celle des cellules vivantes…
Cette bifurcation est hautement significative, en cela qu’elle présage le développement évolutif responsable du passage de l’inerte au vivant. Parlons ici d’un changement de registre où la source externe de chaleur – qui perturbait le liquide au repos – prend un sens nouveau et constructif, dès lors que ce liquide l’exploite pour atteindre et maintenir un mode animé d’existence qui intègre cette source dans sa structure, de nature relationnelle et dépendante. Il n’en va pas autrement du processus adaptatif d’un organisme vivant, tel un lierre qui, plongé dans l’ombre par un mur, transforme cet obstacle en appui pour se hisser à un niveau supérieur d’exposition au soleil.
Or, dans l’histoire du monde, ce processus peut intervenir d’une manière moins flexible. L’organisme alors ne se plie pas aux circonstances, parce que celles-ci sont inchangeables, mais plutôt il les infléchit dans le sens de ses désirs, si au contraire ces circonstances sont changeables. C’est le cas d’un animal qui parvient à éliminer un obstacle.
…
Deux questions maintenant se posent. Qu’est-ce qui justifie la locution nature universelle, comme s’il s’agissait d’une chose une et indivisible à proprement parler, et qu’est-ce qui explique le fait que la nature universelle peut entrer en conflit avec elle-même, en admettant qu’elle soit effectivement une et indivisible ?
La première question en soulève une autre, qui lui est intimement liée : est-il justifiable de parler d’une nature humaine à propos des nombreux caractères distinctifs que possède chaque personne ? Plus précisément, chacun de nous pris individuellement est-il une simple accumulation de ces caractères, sans cohésion ni cohérence, ou est-il davantage que la somme de ses parties, un tout intégré qui fonctionne en qualité d’unité vitale et pensante, si complexe qu’il soit et si déchiré qu’il puisse être entre les divers aspects, parfois contradictoires, de cette complexité ? Un exercice attentif d’observation et d’introspection me dispose à tenir pour vrai le second terme de cette alternative.
Qui plus est, il me convainc déductivement de l’unité fondamentale de la nature universelle, bien que celle-ci apparaisse sous une forme multiple, voire disparate. Pourquoi ? Parce que, d’une part, l’être humain réunit tous les éléments du monde dans une unité fonctionnelle de corps et d’esprit, et parce que, d’autre part, l’idée d’une pluralité de forces discordantes, sans direction d’ensemble, qui seraient néanmoins capables de converger vers une telle unité, est complètement absurde.
Toutefois, je concède que cette direction d’ensemble est d’abord morcelée, aveugle et tâtonnante avant d’adopter, au fil des découvertes, des manières d’être appropriées à ses attracteurs naturels, conditionnés par les circonstances.
Bref, l’unité essentielle de la nature humaine, en tant que forme évoluée de vie animale, implique nécessairement l’unité fondamentale de la nature universelle, en tant que force générative qui se manifeste évolutivement.
…
La nature universelle admet donc deux ordres de réalité distincts et complémentaires, l’un défini relativement à l’autre et vice versa : 1) l’ordre potentiel, qui est latent, à savoir qu’il attend une occasion favorable de se manifester ; il évoque une graine – enfouie dans la terre – qui échappe au regard ; et 2) l’ordre actuel (notre référentiel empirique), qui est manifeste à la faveur de cette occasion ; il évoque une plante qui pousse au grand jour. De fait, ces deux ordres sont indissociables. Une chose ne peut être potentielle sans avoir le pouvoir de s’actualiser dans des conditions propices à cette actualisation, tout comme une chose actuelle présuppose le potentiel de l’être au moment opportun.
…
Qui dit nature universelle dit déterminisme. Il reste alors à découvrir dans quel sens ce terme doit être compris. Déterminisme strict, du genre musique classique où l’on suit fidèlement une ligne mélodique sans prendre de liberté, ou déterminisme souple, du type jazz d’improvisation, où l’on s’inspire vaguement d’une mélodie dont on éprouve à l’extrême la tolérance harmonique ? Question vouée à l’incertitude, puisque le savoir est limité et donc inapte à l’épuiser.
Par conséquent, toute indétermination est susceptible de deux interprétations divergentes, sans qu’il soit possible de trancher d’une façon catégorique. La première donne à croire que l’indétermination résulte d’une mesure incomplète, opposant l’ignorance à la connaissance ; la seconde donne à penser que cette indétermination trahit une nature mixte, qui allie le hasard et la nécessité. Pour ma part, je penche vers cette seconde interprétation.
…
Le contraste entre problème de mesure et fait de nature nous amène à distinguer deux catégories opposées et complémentaires de la pensée, l’une épistémologique (relative aux conditions du savoir) et l’autre ontologique (relative à la nature du réel, qui est l’objet du savoir). Dans quelle proportion ce savoir exprime-t-il cette nature ? Cette question est condamnée à demeurer ouverte, puisque le premier terme de la comparaison (la réalité en tant qu’elle apparaît à notre conscience) est connaissable, tandis que le second (la réalité en tant qu’elle est, indépendamment de notre conscience, advenant que nous prenions cette abstraction au sérieux dans une perspective réaliste) est inconnaissable.
Or, l’efficacité de nos comportements vitaux et de nos démarches expérimentales (efficacité restreinte à un espace de mesure) confirme nos hypothèses sur le fonctionnement du monde. Bref, elle suppose une correspondance entre ce que nous savons et ce qui est. À cet égard, le langage de la sensibilité propre à la perception doit traduire assez fidèlement le langage de la réalité pour fournir une base crédible à la réflexion.
…
Évidemment, pour conférer à sa discipline une apparence d’exhaustivité, un scientifique peut prétendre que la conscience est une illusion. L’inconvénient toutefois est que cette solution de facilité cache une énorme difficulté. Car on ne peut prétendre que la conscience est une illusion sans du même coupaffirmer que la science – qui dépend de la conscience à travers l’expérience et la réflexion – est illusoire, ce qui équivaut à se tirer une balle dans le pied.
Conclusion : le réductionnisme matérialiste – qui à l’en croire fait l’économie de l’esprit, alors qu’il dépense allègrement le capital sensoriel et intellectuel de celui-ci – ne tient pas la route. D’ailleurs, le réductionnisme idéaliste – qui s’assoit confortablement sur la matière en disant à qui veut bien l’entendre qu’elle n’existe pas – prend pareillement le fossé.
Nous en venons ainsi au dualisme, qui ne se résume pas forcément à un clivage ontologique où l’esprit et la matière sont absolument distincts. Nous pouvons fort bien considérer l’un et l’autre comme l’envers et l’endroit d’une même chose, auquel cas le dualisme se change en monisme – qui est assimilable au panpsychisme. L’esprit et la matière sont alors conciliés de sorte qu’ils représentent le signifié et le signifiant d’un logos. Je fais ici allusion au langage de la réalité qui exprime la manière dont les choses se forment ou se transforment (d’où le concept d’information, du verbe latin informare : « donner forme à » et par extension « changer la forme de »). Cette manière est ce que le savoir cherche à traduire par des lois et des principes.
…
L’image d’une fourche me vient à l’esprit pour représenter l’attracteur ambivalent de la nature universelle, tantôt satisfaite d’une quiétude indolente, lorsque les circonstances ne frustrent pas son goût pour l’inertie, tantôt forcée de renoncer à cette complaisance et de poursuivre de haute lutte une paix dynamique d’autant plus virile qu’elle doit inlassablement être reconquise, avec au tournant la triste perspective d’une perte totale. Enfin, quasi totale puisque rien n’est pas rien, dans la mesure où il contient la possibilité de tout. Ainsi, tout part de lui et y revient.
Ce dynamisme viril définit la vie, dont les cellules de convection sont une première esquisse. Et il se trouve que les humains sont à même de la comprendre pour autant qu’ils en fassent régulièrement un objet d’observation attentive et réfléchie. Car nous ne pouvons pénétrer le mystère de l’existence que par la porte de l’expérience. Celle-ci est un présent toujours recommencé, sans cesse investi de tâches aisées ou laborieuses qui sollicitent notre engagement et nous impliquent, bon gré mal gré, dans un rapport paradoxal – en même temps harmonieux et conflictuel – avec notre milieu, naturel et social. Or, c’est à condition de pratiquer la discipline d’observation attentive et réfléchie précédemment évoquée que nous avons des chances d’agir en connaissance de cause avec un certain bonheur.
…
Certes, les sources insalubres de plaisir gustatif, possiblement pour compenser des soucis que l’on devrait plutôt s’appliquer à résoudre, sont des tentations omniprésentes. Nous vivons à une époque décadente où les démocraties ont dégénéré en ploutocraties et abdiquent largement leur rôle de représentants populaires en faveur des grandes sociétés commerciales qui s’enrichissent à nos dépens, en flattant sans vergogne nos goûts les plus dépravés.
Nous aurions toutefois avantage à méditer ce fait incontournable : l’abus des plaisirs que je viens d’évoquer présage à long terme des problèmes de santé qui deviendront à coup sûr des motifs de lamentation. Surtout que ces problèmes ne se bornent jamais à être corporels, car tout se tient. Un corps débilité par la maladie corrompt insensiblement l’esprit, qui finit par adopter une attitude conforme à son manque de vitalité. Il devient spontanément défaitiste ou nihiliste, ou même suicidaire, et toute perspective d’une plénitude physique et morale se ferme à double tour comme une porte blindée.
…
À noter également qu’une bonne hygiène de vie est dans le prolongement du processus vital, qui renouvelle sans cesse les conditions physiologiques de son existence, par une régénération tissulaire et une reproduction sexuée, lesquelles nécessitent un apport d’énergie et de matière puisées dans l’environnement. En d’autres mots, la vie est une fin en soi que l’on peut définir comme une boucle de rétroaction dont l’effet entretient la cause.
Or, qui dit explicitement fin en soi – à propos du sujet humain, vivant et conscient, qui par instinct éprouve un vouloir-vivre – dit aussi implicitement bien en soi, dans la mesure où la vie est jugée désirable parce qu’elle donne à espérer un certain bien-être.
…
Je propose la thèse suivante, qui s’avère profondément unificatrice en dépit de son côté incertain, quant aux aspects animés du monde avec lesquels on parvient mal à s’identifier : loin d’un équilibre « statique » (maxentropie), la nature universelle tend spontanément vers un bien d’une formidable inventivité qui apporte une solution dynamique (néguentropie) au problème du déséquilibre.
…
Pour chaque point évolutif, je me représente un sablier, formé de deux pyramides superposées – l’une inversée, au-dessus, et l’autre non, au-dessous – jointes par les sommets, précisément en ce point où le temps s’égrène au rythme des changements. La pyramide du dessous symbolise le potentiel créateur de la nature universelle, dont l’actualisation ponctuelle et variable se concentre au sommet dans le point en question. Ce point marque également le sommet de la pyramide inversée du dessus, lequel symbolise la naissance d’une entité en développement de nature dissipative ou vivante.
C’est dire que cette nature fait un avec la nature universelle qui la fonde, autant du point de vue de la fin dissipative ou vivante qu’elle poursuit que du point de vue des moyens qu’elle emploie pour atteindre cette fin. Par conséquent, chaque entité naît et meurt sur le plan de sa réalité phénoménale, temporelle, mais aussi transcende ce cycle de naissance et de mort sur le plan de sa réalité fondamentale, intemporelle. De même, une vague apparaît puis disparaît, tandis que l’océan – où elle se forme visiblement pour ensuite se fondre en lui, sous la surface des apparences – demeure infiniment.
…
Je crois utile de souligner que la science (au sens strict de connaissance fondée sur l’observation de la réalité extérieure et le calcul) nous a habitués à des résultats spectaculaires dans son travail de description, de prévision et de manipulation des rapports formels qui prévalent entre les éléments structurels et fonctionnels du monde, si spectaculaires à vrai dire que nous avons développé envers elle des attentes démesurées, sans commune mesure avec son domaine de compétence. Car son formalisme descriptif d’une grande efficacité pratique et technologique cache un choix méthodologique restrictif, à la base du projet scientifique, choix qui remonte à l’âge des lumières et condamne ce projet à l’incomplétude, n’en déplaise à ceux qui prétendent le contraire en limitant le monde à son aspect matériel, pour les besoins de la cause.
Dès le XVIIe siècle, la méthode scientifique s’applique donc tout d’abord aux sciences dites exactes comme l’astronomie, la physique et la biologie, qui sont distinctes de la psychologie (en dehors du behaviorisme), de la sociologie et de la philosophie, entre autres domaines de la connaissance humaine qui néanmoins aspirent de plus en plus à une certaine forme de rigueur expérimentale.
En somme, cette méthode restreint son champ d’investigation aux choses en tant qu’objets, par opposition aux choses en tant que sujets, ce qui exclut la conscience, irréductible au cerveau dont on peut observer l’activité au moyen de l’imagerie fonctionnelle par résonance magnétique.
L’ironie dans tout ça, c’est que l’expérience et la réflexion, sur lesquelles la science repose entièrement, sont tributaires de la conscience. Nous ne sortons jamais de notre tête, à titre de sujets, et rien n’est sûr sinon l’acte de percevoir et de concevoir, tandis que les objets de nos perceptions et de nos conceptions – qui leur sont extérieurs dans une perspective réaliste – posent toujours un problème de fidélité de celles-ci à ceux-là, donc un problème de vérité.
Toutefois, puisque ces objets n’existent qu’en principe, hors de notre subjectivité, nous ne sommes nullement propres à les comparer avec nos représentations. Par conséquent, notre seul critère de vérité est une mesure d’efficacité. Je présume en l’occurrence qu’une inadéquation de notre pensée à la réalité aurait pour effet une inadaptation, ou une incapacité de fonctionner conformément à l’une qui n’aurait alors aucune pertinence relativement à l’autre. Par exemple, si je traverse à l’heure de pointe un boulevard métropolitain en croyant que je parcours un champ de marguerites, où volent paisiblement quelques jolis papillons, le pronostic promet d’être peu encourageant.
…
C’est après des milliards d’années d’évolution que la vie humaine apparaît : forme dynamique la plus évoluée, qui fait preuve d’intelligence pour élaborer une stratégie vitale adaptée à sa situation. Cette intelligence, du reste, n’est possible qu’à condition d’un équipement cérébral extrêmement développé, sans lésions pathologiques, comme le démontrent de multiples façons les recherches sur le cerveau.
En résumé, la volonté instruite par le savoir n’est pas le point de départ de la nature universelle, si prodigieuse que soit sa puissance créatrice, mais son point d’arrivée, à l’issue d’une évolution turbulente – au confluent d’une tendance déterminante et d’un tâtonnement aléatoire – qui s’étale sur des milliards d’années.
…
Je cherche, pour ma part, un juste milieu entre l’ouverture d’esprit et l’esprit critique, en prenant solidement appui sur les acquis de la science, sans pour autant fermer les yeux sur ce qu’il est possible de voir lorsque le regard se tourne vers l’intérieur.
…
La vie humaine, entre autres formes de vie, est au nombre des solutions dynamiques (néguentropie locale + entropie environnante liée à la consommation/dégradation d'énergie et de matière). Elle constitue à ce titre un bien, un pôle d’attraction – par opposition à un mal, un pôle de répulsion – vers lequel la nature universelle tend irrésistiblement.
En d’autres mots, la nature universelle y investit d’instinct ses ressources créatrices, qui sont manifestement immenses, d’où la possibilité d’un bien dans une mesure appréciable, et pourtant limitées, d’où le risque d’un mal dans une proportion détestable. Elle révèle ce mélange parfois indigeste de puissance et d’impuissance dans ses solutions dynamiques au problème du déséquilibre, parmi lesquelles la vie humaine est un exemple évolué, non seulement capable de survie et de bonheur, mais aussi susceptible de souffrir et de mourir. Peut-être sommes-nous appelés à nous montrer reconnaissants et compréhensifs envers la nature universelle, comme à l’égard d’une mère qui manque de moyens sur certains points, malgré un amour sans faille.
Le fait est que l’univers ne donne aucun signe d’omnipotence et d’omniscience en dehors des mythes religieux, qui ont tous en commun de se complaire dans l’hyperbole. Or, cette complaisance n’est pas sans inconvénient. Car un dieu bienveillant qui est de surcroît omnipotent et omniscient complique inutilement le problème de la souffrance et de la mort. La leçon est simple : quiconque rêve à un château de conte de fées, en espérant de cette chimère qu’elle devienne réalité, confère à sa maison une allure de taudis. Au total, ni miracle ni prophétie n’ont été jusqu’à ce jour davantage que des anomalies invraisemblables en attente d’explications ordinaires.
La nature universelle n’a pas le lustre de ce dieu transfiguré par des superlatifs, mais il faudrait ne pas voir clair pour la juger terne, tant le déploiement de son génie créateur a de quoi nous éblouir. Cet éblouissement est donc fonction d’un esprit éveillé, grâce auquel la nature humaine contribue à l’éclat de la nature universelle dont elle est le produit.
Ce changement de point de vue – qui va de la nature universelle à notre nature humaine et inversement – est aussi trompeur que révélateur. Notre nature reste formellement humaine, finie dans l’espace et dans le temps, quoique la nature solutions locales et transitoires au problème du déséquilibre, autant de biens conditionnels vers lesquels elle gravite spontanément. C’est d’abord en ce sens qu’elle les aime, alors que notre statut d’Homo sapiens (du latin homo « être humain » et sapiens « sage ») nous destine à les aimer en connaissance de cause, grâce à une élévation d’esprit qui participe de notre identification avec la nature universelle : fond créateur de notre forme humaine.
…
Cela dit, il y a une autre façon d’élever notre esprit à une hauteur morale, qui nous amène à transcender la bienveillance nécessaire mais insuffisante d’un amour centré sur nous-mêmes. De fait, nous ne sommes rien individuellement en dehors des relations d’interdépendance qui nous lient intimement à notre environnement social et naturel, comme aux conditions universelles de cet environnement.
Ainsi, la famille humaine et la Terre mère ne sont pas de vains mots, d’autant qu’elles constituent notre milieu nourricier, en dépit des rigueurs auxquelles elles nous exposent. Et il en va de même du cosmos, qui est le berceau de notre planète, laquelle est comparable à une pièce de casse-tête qui ne prend tout son sens que par rapport à l’ensemble.